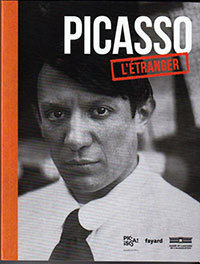 « Picasso, l’étranger », Musée national de l’histoire de l’immigration, Paris, novembre 2021, pages 262-264.
« Picasso, l’étranger », Musée national de l’histoire de l’immigration, Paris, novembre 2021, pages 262-264.
Par Benjamin Stora.
Le 8 février 1962, une manifestation organisée par la gauche française pour la paix et l’indépendance de l’Algérie est violemment réprimée au métro Charonne à Paris. Parmi les manifestants qui tentent de se réfugier dans la bouche de la station de métro, huit personnes trouvent la mort, étouffées ou à cause de fractures du crâne, ainsi qu’une neuvième à l’hôpital des suites de ses blessures. L’émotion en France est immense. Un million de Parisiens assisteront aux funérailles des morts de Charonne.
Le même jour, ce 8 février 1962, un dessin réalisé au fusain paraît à la Une du magazine, Les Lettres françaises. Picasso, peintre éminemment célèbre, a dressé le portrait de Djamila Boupacha, militante algérienne torturée et violée durant sa détention. Son procès a suscité un grand mouvement de protestation. Le dessin de Picasso sera en couverture du livre-plaidoyer de Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi en faveur de la militante algérienne, publié aux éditions Gallimard[1].
Ces deux événements disent toute l’intensité des engagements anticolonialistes de Picasso à quelques semaines de la signature des Accords d’Evian, du 19 mars 1962, inaugurant le chemin menant à l’indépendance de l’Algérie. Picasso est donc au premier rang de cette bataille. Cet engagement est-il le prolongement d’une passion pour les arts non-occidentaux situés en territoires colonisés ? Donc s’inscrivant dans une longue histoire de critique de l’action coloniale ? Retour en arrière sur les rapports entre pratiques artistiques et regards politiques.
La révolution du regard.
La révolution du regard.
En 1920, le peintre est sollicité par un critique d'art, dans le cadre d’une série d'interviews sur « l'art nègre ». Le critique demande à Picasso une quinzaine de lignes dans l'urgence. Picasso, envoie rapidement un texte comprenant cette phrase devenue célèbre : « L’art nègre ? Connais pas ! » Il s'en expliquera par la suite : son goût pour ces arts dits « primitifs » n'est pas ethnographique. L'artiste ne s’intéresse pas aux usages traditionnels des objets, mais à leurs formes, leur force, leur magie même. Comme le montre sa collection personnelle, les arts d’Afrique, d’Océanie, des Amériques et d’Asie n’auront cessé de l’accompagner, notamment dans ses différents ateliers, comme en témoignent les documents, lettres, objets et photographies réunis dans l’exposition au quai Branly en 2017.[2]
Picasso a été inspiré par les arts océaniens et africains, et particulièrement les masques africains. Il s'était notamment rendu en 1907 au musée du Trocadéro, le premier musée d'ethnographie de Paris, fondé en 1878. Après sa vite au Musée du Trocadéro, il veut s’affranchir des procédés de restitution du réel. Il entame un exigeant travail autour du projet des Demoiselles d’Avignon. Pour soutenir sa recherche d’analyse et de simplification de la forme il utilise des clichés ethnographiques et des cartes postales « de type indigènes africains »[3]. L’étude que conduit Picasso à partir de l’été 1907 de l’art africain et océanien « reste centrale pour comprendre pour comprendre le développement de son œuvre »[4]. La nouveauté du tableau entraine étonnement et consternation chez les proches de l’artiste. Georges Braque déclare à Daniel-Henry Kahnweiler : « Les Demoiselles d’Avignon ? C’était comme si quelqu’un buvait du pétrole pour cracher du feu ». Pour Henri Matisse et Leo Stein, médusés, le tableau s’aventure du côté de « la quatrième dimension ». On accusera ensuite Picasso (comme les surréalistes dans les années 1920-1930), de plagiat ou de « vol » des trésors de l’art africain. Il est vrai que le regard porté sur l’esthétisme venant d’Afrique ne signifie pas un engagement concret aux côtés de colonisés dépossédés de leur héritage culturel. Mais Picasso ne considère pas cet art comme une manifestation d’un stade de non-développement. Son attitude « politique » est révélatrice d’une recherche de l’altérité créatrice. Ce n’est donc pas une attitude « d’appropriation culturelle » comme on dirait aujourd’hui, mais un moyen d’accès aux couches les plus profondes, intimes et fondatrices de l’humain dans son caractère universel, dans toutes les contrées. Dans ce gout pour les coïncidences artistiques comme vérité de l’existence, s’affirme la peinture de ce que l’on pourrait définir comme une authentique et concrète liberté.
Dans la décolonisation.
C’est après la seconde mondiale, au moment où s’exprime la volonté politique des peuples colonisés d’accéder à leur indépendance, que l’on trouve la trace d’un engagement direct de Picasso sur la question coloniale. Aimé Césaire et Pablo Picasso se rencontre en 1948, au congrès des intellectuels pour la paix à Wroclaw, en Pologne. Césaire est alors maire de Fort-de-France et député de la Martinique élu sur la liste du parti Communiste dont Picasso est également membre depuis octobre 1944. L’admiration mutuelle et l’amitié vont se matérialiser de manière créative avec notamment les gravures exécutées en 1949 par Picasso pour illustrer le recueil Corps perdu, qu’on a pu voir dans une exposition en 2011. [5] Dix poèmes de Césaire sont illustrés par trente deux gravures de Picasso. « Le peintre imagina hybridations, femmes-fleurs, homes-plantes, sexes-racines, en écho à la poésie de Césaire, gorgés d’explosions volcaniques, d’éclosions végétales et de forces telluriques enracinés dans une végétation luxuriante. »[6]
Peintre, sculpteur, graveur et céramiste, Pablo Picasso revisite à ce moment des chefs-d’œuvre comme Les Menines de Velásquez (1957) et Le Déjeuner sur l’herbe de Manet (1959-1961), dont il tire respectivement quatorze et vingt-sept variations. Parmi les œuvres ainsi interrogées, par ce maître du dessin et de la dislocation des formes, figure Femmes d’Alger dans leur appartement d’Eugène Delacroix. De décembre 1954 à février 1955, alors que Matisse vient de mourir et que débute la guerre d’Algérie, Picasso confronte son regard avec le fameux tableau. Il en sort quinze toiles et deux lithographies portant le même titre de Femmes d’Alger. En les peignant nues et inondées de lumière, écrit en substance l’écrivaine Assia Djebar, Picasso a libéré les Femmes d’Alger de la posture de belles de harem chez Delacroix, préfigurant ainsi la génération des « porteuses de feu » de la Bataille d’Alger. Picasso, contrairement à Delacroix, s’ingénie à peindre, à explorer la réalité invisible, profonde et essentielle qui se cache derrière toute réalité visible, jugée superficielle.
Le 19 septembre 1956, la Sorbonne accueille le premier Congrès des écrivains et artistes noirs. Il s’agit du rassemblement, organisé par la maison d’édition Présence Africaine, des plus grands intellectuels noirs venus d’Afrique et des Amériques. « Ce jour sera marqué d’une pierre blanche. Si depuis la fin de la guerre, la rencontre de Bandung constitue pour les consciences non européennes, l’événement le plus important, je crois pouvoir affirmer que ce premier Congrès mondial des hommes de Culture noirs, représentera le second événement de cette décade ». Dans l’amphithéâtre René Descartes de la Sorbonne, Alioune Diop, intellectuel sénégalais qui a fondé la revue Présence africaine, affiche ses ambitions: faire de ce Congrès un « Bandung culturel » et favoriser l’expression sur la scène internationale des idées progressistes d’intellectuels issus de peuples que certains estiment encore sans culture. Aimé Césaire, député maire de la Martinique et chantre de la négritude, pose le caractère anticolonial du colloque : « On ne peut pas poser actuellement le problème de la culture noire, sans poser le problème du colonialisme, car toutes les cultures noires se développent à l’heure actuelle dans ce conditionnement particulier qu’est la situation coloniale ou semi-coloniale ou para-coloniale ». Le Congrès, développe une critique de la mécanique coloniale à l’image de l’intervention du Martiniquais Frantz Fanon, psychiatre exerçant alors en Algérie et auteur de Peau noire, masques blancs (1952). Plusieurs personnalités de renom ont apporté leur appui comme Jean-Paul Sartre, André Gide, l’anthropologue Claude Lévi-Strauss ou le peintre Pablo Picasso, auteur de l’affiche du congrès. « Artistes et poètes reviennent toujours au même pays natal, quelque soit leur couleur. Salut fraternel au congrès des hommes de culture noire », écrit Picasso dans la dédicace qui signe l’affiche de ce congrès[7].
Effervescences.
L’œuvre de Picasso est une véritable révolution du regard en direction du monde colonisé. Elle déborde du champ limité de l’esthétique, ne cherche pas à se « ressourcer » auprès de sociétés traditionnelles, survivances de la pénétration coloniale. Elle s’inscrit dans un processus de remise en cause d’une vision unique et homogène de l’histoire, donc de libération des individus. Picasso nous entraine, du début à la fin de la colonisation, dans une « odyssée » qui condense toutes les qualités à la fois : celle du désenchantement à l’égard de l’occident, d’un réveil de la conscience anticoloniale, d’un retour vers un passé perçu comme un souvenir quelquefois fantasmé, d’une espérance vers une société libérée qu’il veut en effervescence.
Benjamin Stora.
[1] Ce dessin était visible à Alger lors de l’exposition « Les artistes et la Révolution algérienne », avril-juin 2008.
[2] L’exposition, « Picasso primitif » s’est déroulée du mardi 28 mars 2017 au 23 juillet 2017 au musée du Quai Branly à Paris.
[3] « Picasso et la photographie coloniale », par Anne Baldassari, in Zoo humains, Ed La Découverte, 2004, pages 340 à 348. « Par « photographie coloniale », on désigne communément une pratique de la prise de vue qui s’est développée pendant plus d’un siècle sur l’ensemble des continents aussi bien qu’à l’occasion des expositions coloniales ou des « exhibitions » d’indigènes. Cette entreprise sans précédent de mise en images de l’Autre a décliné les figures de la domination visuelle dans un champ d’investigation, allant de l’étude à visée ethnographique au simple cliché pittoresque. »
[4] Musée Picasso, Catalogue, « 1895-1905 », Ed Flammarion, page 3, 2014.
[5] Aimé Césaire, Lam et Picasso », sous ce titre, une exposition au Grand Palais à Paris a célébré du 16 mars au 6 juin 2011 la rencontre entre le poète antillais et les deux peintres, le Cubain et l’Espagnol. Une rencontre placée sous le signe de l’art que les trois artistes ont en partage, de l’Histoire dont ils portent les blessures, et de leur engagement contre ceux que Césaire appelle les « assassins d’aube ».
[6] Annie Cohen-Solal, Un étranger nommé Picasso, Paris, Ed Fayard, 2021, page 577.
[7] Pour une approche d’ensemble de cette période : Art et résistance au Maghreb et au Moyen-Orient, de 1945 à 2011, coordonné par Anissa Bouayed et Chantal Chanson-Jabeur , Paris, Ed L’Harmattan, 2021.


















































