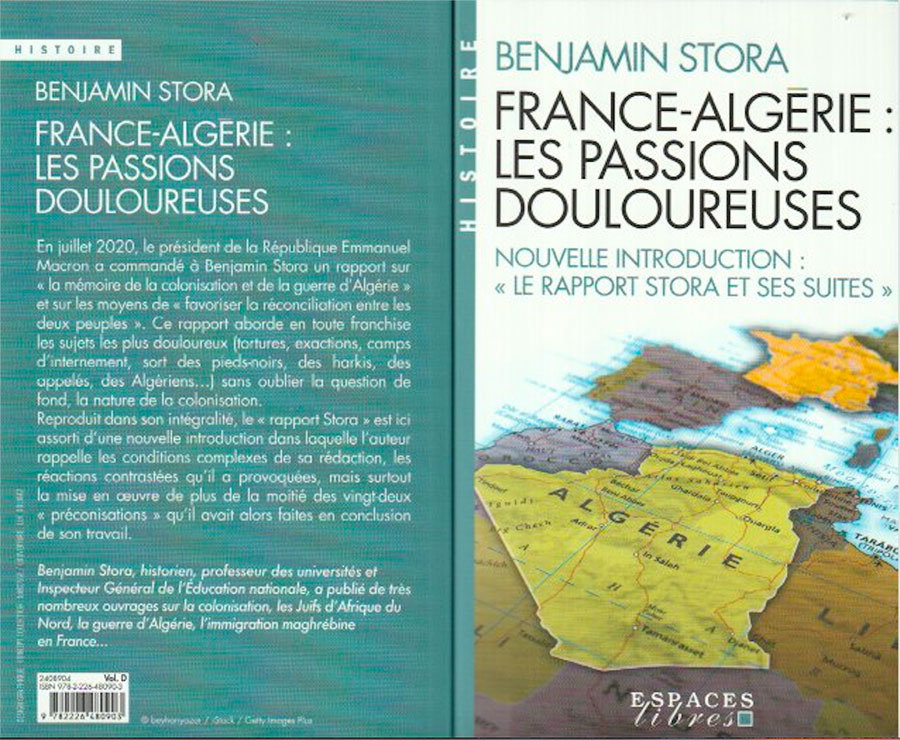Nouvelle introduction à l’édition de poche (février 2023) - Le « Rapport Stora » et ses suites.
Nouvelle introduction à l’édition de poche (février 2023) - Le « Rapport Stora » et ses suites.
Un historien dans la mêlée. Par Benjamin Stora.
« Il s’agit de servir la dignité de l’homme par des moyens qui restent dignes au milieu d’une histoire qui ne l’est pas. [...] Tant il est vrai que l’Histoire n’est que l’effort désespéré des hommes pour donner corps aux plus clairvoyants de leurs rêves ».
Albert Camus.
Le 20 janvier 2021, à la demande du président de la République française, je remettais un rapport sur « la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie » commandé six mois plus tôt. Ce rapport a été publié aux éditions Albin Michel en mars 2021 sous la forme d’un ouvrage : France-Algérie, les passions douloureuses, intégralement repris dans cette nouvelle édition Cette publication a provoqué pendant plusieurs mois un flot de commentaires, de critiques mais aussi d’approbations et, surtout, de discussions vives.
Dès le jour de sa publication, le rapport a été débattu – essentiellement en visioconférence en raison de l’épidémie de Covid-19 – dans des universités américaines comme Columbia et New York University, mais aussi dans le cadre d’organisations comme la Ligue des droits de l’Homme ou le groupe d’amitié France-Algérie à l’Assemblée nationale. Certains trouvaient mon texte beaucoup trop « tiède », pas assez accusateur d’un système colonial qui ne tolérait pas la moindre possibilité de contacts entre « Européens » et « Indigènes » ; d’autres, au contraire, jugeaient trop défavorable son bilan de la présence coloniale française – quand ils ne rejetaient pas purement et simplement l’ensemble de mon travail en arguant de «la mission civilisatrice» de la France au temps de la colonisation, ce dernier argumentaire émanant souvent de personnalités proches de l’extrême droite. D’autres exprimaient le regret que ce travail n’ait pas été effectué dans un cadre plus académique, sous la forme d’une commission réunissant plusieurs dizaines d’historiens spécialistes de la question qui aurait examiné en premier lieu les rapports complexes entre histoire et mémoire – ce qui aurait représenté de très nombreuses années de travail. Des comptes-rendus ont paru dans Le Monde (sous la signature de Frédéric Bobin), L’Obs (Nathalie Funès), Marianne (Martine Gozlan) ou encore dans Jeune Afrique (Renaud de Rochebrune). Le rapport a été aussi débattu dans des revues comme AOC (Ana- lyse Opinion Critique[1]). Certaines réactions m’ont blessé, comme ces textes d’universitaires parisiens pointant le faible nombre de références bibliographiques dans mon rapport, comme s’il s’était agi d’une thèse de doctorat. Des critiques quelquefois virulentes venant d’Algérie ont prétendu que j’aurais volontairement minimisé les exactions commises au temps colonial, alors même que j’ai consacré une grande partie de vie à explorer l’histoire du nationalisme algérien, donc à travailler sur les résistances à la colonisation : ma première thèse, consacrée au leader algérien Messali Hadj, a été soutenue en 1978, et ma biographie d’un autre grand dirigeant algérien, Ferhat Abbas, a été publiée en 1994. D’autres exigeaient des excuses de la France comme préalable à toute discussion sur les préconisations énoncées en conclusion de mon rapport.
Dans le même temps, de nombreuses voix se sont élevées pour soutenir ma démarche. Le président de la République Emmanuel Macron a répondu positivement à mes sollicitations et, au cours de discussions que nous avons eues ensemble après la publication de mon rapport, il a montré sa détermination à poursuivre ce travail de mémoire, si difficile et périlleux. Je me souviendrai toujours de ce grand moment d’émotion où, recevant à l’Élysée le 4 mars 2021 les petits-enfants d’Ali Boumendjel, dirigeant du nationalisme algérien assassiné au moment de la bataille d’Alger en mars 1957, il leur a demandé pardon au nom de la France. Autre temps d’émotion, le 16 octobre 2021, quand il a tenu à être présent à la cérémonie d’hommage aux travailleurs algériens assassinés par la police parisienne le 17 octobre 1961 et quand il a rendu hommage aux harkis et à leurs descendants en recevant leurs représentants en mars 2022 au palais de l’Élysée.
Plusieurs acteurs de la société civile (universitaires, journalistes, membres d’associations de défense des immigrés, des droits de l’homme, des harkis, des anciens appelés, des pieds-noirs) ont relevé que la démarche inédite initiée par ce rapport permettait d’ouvrir une brèche sur la si délicate question mémorielle. Ainsi, les historiens Gilles Manceron, Pascal Blanchard ou Alain Ruscio disent avoir tiré de ma démarche des moyens d’avancer concrètement sur la résolution des difficultés mémorielles. D’autres historiens et chercheurs en sciences humaines comme Tramor Quemeneur, Naïma Yahi, Tassadit Yacine, Jacques Frémeaux, Laetitia Bucaille, Karima Dirèche, Catherine Brun et Abderahmen Moumen ont accepté de participer aux travaux de la Commission mise en place après mon rapport, de même que des responsables associatifs comme Georges Morin (président de l’association Coup de Soleil et organisateur du Maghreb- Orient des livres), Didier Nebot (président de l’association MORIAL, qui perpétue la mémoire culturelle de la communauté juive d’Algérie), Agnès Aziza (membre de l’association des amis des cimetières de Saint-Eugène Bologhine à Alger), le psychiatre Amine Benyamina (qui a organisé des colloques importants sur les traumatismes laissées par la guerre d’Algérie dans les sociétés française et algérienne) ou Fadila Khattabi, présidente du groupe d’amitié France- Algérie à l’Assemblée nationale. En Algérie même, des voix, certes plus discrètes, se sont fait entendre et exprimaient l’espoir que ce rapport contribue à encourager la production, par des Algériens, d’études scientifiques sur toute la période coloniale. Des historiens algériens comme Amar Mohand-Amer ont ainsi demandé l’ouverture des archives algériennes, tandis que des écrivains comme Yasmina Khadra et Kamel Daoud ont manifesté de l’intérêt pour mon travail[2].
Le pouvoir algérien a pour sa part longtemps gardé le silence, arguant que mon rapport serait « exclusivement franco-français ». Aussi à l’été 2020, il a missionné pour rédiger son propre rapport, son conseiller du président de la République chargé des Archives et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi. Ledit rapport n’a à ce jour toujours pas été remis. Les positions ont néanmoins connu une évolution : le 1er juillet 2022, dans un entretien accordé au quotidien El Moudjahid, le président du Conseil de la nation (c’est-à-dire la Chambre haute) a considéré que la décision du président Emmanuel Macron de faciliter l’accès aux archives classifiées de plus de cinquante ans constituait «un geste à la fois hautement positif et très important ». Il y affirmait également que le « pardon et la repentance seront [...] le ciment qui va conforter nos relations, en laissant par la suite aux historiens le soin de travailler sur la Mémoire ». Quelques jours plus tard, le président Abdelmadjid Tebboune me recevait à Alger le 4 juillet 2022 à la veille de la célébration du soixantième anniversaire de l’indépendance algérienne. J’étais alors porteur d’un message du Président français au Président algérien pour reprendre et poursuivre des relations dans ce domaine si important. Le Président algérien a insisté sur « l’importance majeure d’un travail de mémoire sur toute la période de la colonisation », et a proposé la constitution d’une Commission d’historiens français et algériens pour étudier et livrer des documents au grand public sur l’histoire de la colonisation française en Algérie.
Comment ce rapport a été écrit
Les conditions d’élaboration de ce rapport sont très éclairantes sur ses objectifs et ses intentions. La lettre officielle de mission, signée le 24 juillet 2020 par le Président Emmanuel Macron, disait comment était venue l’idée de ce rapport :
«Conscient et respectueux de vos engagements, je souhaite pouvoir compter sur votre expérience et votre connaissance intime et approfondie de ces enjeux pour nourrir nos réflexions et éclairer nos décisions, en vous confiant une mission de réflexion. Je souhaite que vous dressiez un état des lieux juste et précis de ce qui a d’ores et déjà été accompli dans notre pays sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie ainsi que de la perception qui en est retenue, de part et d’autre des deux rives de la Méditerranée. »
Il importe de mettre en lumière dès à présent les difficultés d’écriture autour de toute cette histoire. L’histoire de la colonisation est à la fois un « récit des faits passés » et une histoire immédiate. Si la présence coloniale de la France en Algérie a pris fin en 1962 et constitue donc un fait distant de plus d’un demi-siècle, les circonstances très particulières de la guerre d’Algérie font que son histoire est réellement inséparable d’une mémoire qui est encore en partie au moins vivante, et non reconstruite a posteriori. Nous sommes donc non seulement face à la classique dualité de l’« histoire » et de la « mémoire », mais plus encore pris dans le triple nœud de l’histoire, de la mémoire et de la politique. Évoquant mon rapport, l’historien algérien Tahar Khalfoune a bien résumé les termes de cette « circulation » entre trois pôles :
« Il est heureux que la recherche historique instruise et éclaire en l’occurrence les politiques, car là où les politiques décident et les historiens suivent, l’effet peut être contreproductif ; d’autant que le pouvoir politique tend non seulement à instrumentaliser l’histoire, mais il est souvent en retard sur les acquis de la connaissance historique. Il n’appartient pas à l’État de dire la vérité en histoire. Rendons donc grâce à ce travail qui a per- mis d’ouvrir le débat sur ces questions brûlantes pouvant faire évoluer la société française et dépasser les conservatismes, si le rapport et ses recommandations bénéficient de l’attention et de l’intérêt qu’ils méritent.[3] »
Une première étape du travail consistait à établir un état des lieux de ce qui avait été accompli en France en termes historiographiques et mémoriels dans le domaine de l’éducation, des commémorations et des productions culturelles (livres, films, expositions), ainsi que dans le domaine politique, avec les gestes déjà posés par les présidents de la République française successifs, depuis Jacques Chirac jusqu’à Emmanuel Macron : reconnaissance des massacres de mai-juin 1945 à Sétif et Guelma en 2005, restitution en 2008 aux autorités algériennes des cartes de mines posées aux frontières, condamnation du massacre d’Algériens à Paris d’octobre 1961 en 2012, reconnaissance de l’assassinat du militant communiste Maurice Audin en 2018, restitution des crânes de résistants algériens (en 2021, après la publication du rapport, mais promise en 2017). En retour, cela permit de dresser l’inventaire de ce qui restait encore à accomplir, par exemple sur les archives ou les essais nucléaires, l’abandon des harkis ou encore la recherche des disparus de la guerre d’Algérie. Les préconisations découlant de ce travail ne visaient pas à satisfaire séparément chacun des groupes concernés par cette histoire douloureuse, entretenant ainsi une sorte de cloisonnement des mémoires, mais de parvenir à rassembler l’ensemble des groupes concernés, notamment par le biais des manuels scolaires, d’échanges de jeunes, ou d’ouvrages en différentes langues.
Ma mission n’était donc pas d’écrire une « nouvelle histoire de l’Algérie contemporaine » – ce qui a été source de bien des méprises dans la réception du rapport – mais bien de mesurer les effets de la colonisation et de cette guerre d’indépendance algérienne dans la fabrication des mémoires des différents groupes, en France essentiellement. Cette demande sur les effets de mémoires se situait dans le droit fil de mes ouvrages précédents : La Gangrène et l’Oubli (La Découverte, 1991), Le Transfert d’une mémoire (La Découverte, 1999) et Les Mémoires dangereuses (entretiens avec Alexis Jenni, Albin Michel, 2015).
Autre source de confusion : le rapport ayant été commandé par l’État, j’aurais par définition effectué un travail « politique ». Or il existe en France une tradition de commande de rapports par l’État, lequel sollicite pour cela des experts sur les questions qui relèvent de leur domaine de compétence, que ce soit sur l’histoire du terrorisme (l’historien Henry Rousso a ainsi remis fin 2018 un rapport intitulé Terrorisme : faire face. Enjeux historiques et mémoriaux), sur l’attitude de la France lors du génocide rwandais (rapport de Vincent Duclert, La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi (1990-1994) remis en avril 2021) ou encore sur les dispositifs de reconnaissance et de réparation mis en œuvre en faveur des harkis. Ce dernier rapport du préfet Dominique Ceaux, « Aux harkis, la France reconnaissante », remis en 2018, traite en profondeur de l’histoire des harkis, ce qui me permettait de ne pas aborder plus longuement ces questions dans mon propre rapport. Or ces documents et leurs préconisations ne trouvent pas forcément d’application effective : cela relève des décisions du monde politique, et les auteurs des rapports n’ont pas la main là-dessus. Ce n’est donc pas en tant que « fonctionnaire de l’Élysée » ou « de conseiller » que j’ai travaillé, comme certains me l’ont reproché dans Médiapart, mais comme historien universitaire. Je ne suis pas un « représentant de l’État français », mais un chercheur qui a consacré un demi- siècle de son existence à travailler sur cette histoire. J’avais par ailleurs déjà rédigé plusieurs rapports, qui avaient abouti à des préconisations : l’un sur La recherche sur les migrations et l’immigration. Un état des lieux (2016), à la demande du ministère de la Recherche, l’autre sur Culture et migrants (2019), tous deux rédigés alors que j’étais président du conseil d’orientation du Musée national de l’histoire de l’immigration (de 2014 à 2020).
Pour ce rapport, j’ai travaillé seul, sans assistance particulière ni rémunération[4]. Dans les circonstances particulières de la pandémie de Covid-19, j’ai recueilli les témoignages d’une quarantaine de personnalités ou de membres d’associations, soit à ma demande, soit qu’ils m’aient sollicité directement : des appelés du contingent, des opposants à cette guerre, des représentants du monde « pied-noir », des fils de harkis, mais aussi des descendants de l’immigration algérienne en France, des chercheurs travaillant sur les essais nucléaires...
Tous m’ont fait part de leurs revendications particulières, que ce soit pour la commémoration d’événements tragiques comme la journée du 17 octobre 1961 pour les enfants d’immigrés, le 26 mars 1962 pour le massacre de pieds-noirs de la rue d’Isly à Alger, ou le 19 mars, date du cessez-le-feu à la suite des accords d’Évian signé la veille, pour les appelés. J’ai aussi rencontré des représentants d’institutions directement concernés par cette histoire : les archives, avec la directrice des Archives nationales françaises et toute son équipe ; le directeur de l’Agence française de développement et son équipe pour le développement d’actions culturelles dans le domaine de la mémoire ; les équipes de la conservation du patrimoine en France ; des médecins et psychiatres travaillant sur les traumatismes de guerre ; des professionnels des métiers du livres, éditeurs mais aussi l’équipe de l’association Coup de soleil; des représentants d’associations luttant contre les essais nucléaires en Algérie effectués dans les années 1960; des représentants des associations de familles des disparus ; des membres du comité Maurice-Audin; des responsables antiracistes, de SOS Racisme ou de la Ligue des droits de l’Homme avec Gilles Manceron ; des militants associatifs liés à l’histoire culturelle de l’immigration, de Beur FM comme Nacer Kettane et Naïma Yahi, ou des mouvements culturels berbères ; également des représentants d’associations pour la sauvegarde des cimetières en Algérie, comme Agnès Aziza ou Didier Nebot.
À l’occasion de toutes ces rencontres, j’ai pu mesurer les demandes mémorielles très fortes, toujours exprimées soixante ans après l’indépendance de l’Algérie. C’est à partir de ces entretiens que j’ai pu élaborer différentes préconisations. Hélas, dans ces circonstances si particulières, je n’ai pas pu accéder à toutes les demandes. Je regrette, par exemple, de ne pas avoir rencontré les représentants des familles des victimes terrorisme de l’OAS, comme Jean-François Gavoury (fils de Roger Gavoury, commissaire central d’Alger assassiné par l’OAS, et président de l’Association nationale pour la protection de la mémoire des victimes de l’OAS ou ANPROMEVO) et Jean-Philippe Ould Aoudia (dont le père, inspecteur des centres sociaux éducatifs en Algérie, a été assassiné lors de l’attentat de Château-Royal du 15 mars 1962) ; d’autres représentants d’historiens militant pour l’ouverture des archives, comme Gilles Morin ou Raphaëlle Branche. Je regrette également de n’avoir pas pu rencontrer d’autres associations de filles et fils de harkis.
J’ai accepté ce travail en relation avec mes convictions anciennes : affronter le passé colonial et faire évoluer les connaissances sur cette longue période. Des propositions ont été formulées en vue des préparatifs de la célébration du soixantième anniversaire des accords d’Évian et donc de l’indépendance de l’Algérie, en mars 2022, soit dans les dernières semaines de la campagne électorale pour la présidentielle. Or, dans un pays comme la France dont l’«identité nationale » se veut plus politique que culturelle ou ethnique, la mise en récit de l’histoire n’a pas manqué d’occuper une place importante dans les discours des principaux candidats, d’autant que la « question algérienne » ressurgit toujours dès que l’on parle d’immigration ou d’islam. Soucieux de préserver mon indépendance de chercheur par rapport aux enjeux directement politiques, j’ai mis un soin particulier à dissocier ces deux échéances en ne rencontrant pas les représentants des formations politiques. On ne saurait me tenir personnellement rigueur des usages politiques que d’autres personnes et partis, s’adressant à des clientèles électorales précises, ont pu faire de mon travail, et dont j’analyserai plus loin des exemples.
Des réceptions diverses
Le fort retentissement médiatique et politique qu’a connu la remise du rapport le 20 janvier 2021 montre que les questions de la guerre d’indépendance algérienne et de la colonisation restent un sujet toujours brûlant en France comme en Algérie. Une bonne part des réactions suscités étaient attendues. D’un côté, il y a ceux qui prétendent qu’il vaudrait mieux ne pas toucher à cette histoire dont les plaies sont encore susceptibles d’être ravivées. « Attention à ne pas ajouter de la souffrance à la souffrance », dit leur refrain bien connu. Ce discours, qu’on entend en France depuis très longtemps à propos de l’histoire coloniale en général et de l’Algérie en particulier, a pour effet... qu’on ne fait rien. Cette attitude prédomina dans le domaine politique pratiquement depuis 1962, jusqu’à la fin de la présidence de François Mitterrand ; il a fallu attendre l’arrivée de Jacques Chirac à la présidence de la République en 1995 pour que l’on puisse regarder en face cette histoire. D’autres, à l’inverse, déplorent que le rapport n’aille « pas assez loin » : ils voudraient faire de l’histoire coloniale le facteur unique d’explication de tous problèmes sociaux, culturels, et politiques que la France (et l’Algérie) connaît aujourd’hui. Ce positionnement idéologique a pour effet d’entretenir une guerre sans fin des mémoires et une attitude de ressentiment impossible à surmonter. En fin de compte, ces deux positions, en apparence diamétralement opposées, se rejoignent en ce qu’elles se réfugient derrière des prétextes idéologiques pour ne rien entreprendre et se fabriquent des « rentes mémorielles » afin de satisfaire leur clientèle électorale.
La condamnation immédiate par l’extrême droite de mon rapport, dépeint comme « favorable aux porteurs de valises du FLN », n’a surpris personne ; Louis Alliot, maire RN de Perpignan, ancien vice-président du FN a même déclaré que ce rapport était une « honte nationale ». Les protestations véhémentes de filles et femmes de harkis[5], dénonçant ce texte comme trop favorable au nationalisme algérien et s’opposant à ma préconisation de faire entrer Gisèle Halimi au Panthéon au motif qu’elle aurait tenu des propos injurieux envers les harkis étaient à peine moins attendues – même si j’en ai été meurtri. Dans le débat très vif sur l’histoire de la communauté harkie et leur liberté de circulation entre les deux pays, j’ai pourtant pointé la responsabilité de la France à la fois dans l’abandon des troupes supplétives de son armée, et dans les conditions indignes de leur accueil en France ; mais cette prise de position n’a pas été entendue.
Il y a cependant eu aussi quelques surprises. En recevant de nombreuses personnes, j’ai pu constater l’hétérogénéité, voire l’éclatement en France des groupes porteurs de la mémoire de la guerre d’Algérie : militaires, pieds- noirs, immigrés et leurs enfants, harkis. Surtout, au sein même de chacun de ces groupes, j’ai pu constater qu’il n’existe pas de vision unique. Parmi les pieds-noirs, certains cherchent à magnifier l’œuvre coloniale tandis que d’autres veulent avancer et dépasser cette vision. On observe la même attitude chez les anciens militaires, officiers ou soldats d’Algérie et parmi les descendants des communautés harkies : certains proposent d’avancer tandis que d’autres énoncent des préalables en posant des conditions a priori, de dénonciation ou de valorisation du système colonial.
Côté algérien, on a évidemment retrouvé les exigences connues d’une « repentance » française posée comme préalable à toute discussion. On a ainsi pu lire dans le quotidien officiel algérien, El Moudjahid, du 9 mai 2021, que « l’exigence d’un règlement global et définitif de la question mémorielle est tributaire du devoir de vérité historique englué par une vision réductrice présentée dans le rapport de préconisation par l’historien Benjamin Stora occultant le génocide du 8 mai 1945 et les crimes coloniaux commis pendant plus d’un siècle de présence coloniale. Il ne peut y avoir de véritable réconciliation mémorielle sans une reconnaissance officielle, définitive et globale des crimes contre l’humanité dénoncés depuis longtemps ». L’accueil officiel du « rapport Stora » a été exprimé par le ministre de la Communication Ammar Belhimer, à l’époque également porte-parole du gouvernement, pour qui « le travail de l’historien français occulte les revendications légitimes de l’Algérie, en particulier la reconnaissance officielle par la France des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, perpétrés durant les 130 années de l’occupation de l’Algérie ». Telle fut la posture dominante, également exprimée par – ou au travers – des organisations comme l’Organisation Nationale des Moudjahidines (ONM). On notera cependant que la position officielle de la présidence algérienne n’a jamais été explicitée : bien qu’elle n’ait pas officiellement rejeté le rapport – pourtant remis aux autorités, et traduit en langue arabe et anglaise – celui-ci n’a jamais été publié en Algérie et présenté au public de ce pays[6].
Dans son texte cité plus haut, l’historien Tahar Khalfoune, s’est livré à une revue de la presse algérienne, qui «a consacré au Rapport Stora plusieurs dizaines d’articles ; le quotidien L’Expression a publié à lui seul pas moins d’une cinquantaine d’entretiens et d’articles, sans compter les papiers parus dans d’autres journaux comme El Watan, Liberté, Le Matin... y compris la presse arabophone. Les réactions sont si abondantes qu’il est difficile de les synthétiser, ce qui témoigne à l’évidence de son intérêt. Certaines sont ouvertement critiques, notamment celles exprimées par des officiels algériens qui lui reprochent grosso modo d’avoir omis de préconiser des excuses pour les crimes coloniaux. L’historien est conscient de la complexité de la mission qui lui a été confiée et des réactions enflammées que son travail est susceptible de soulever tant en France qu’en Algérie. D’autres réactions lui sont au contraire favorables émanant d’historiens et d’universitaires qui ont salué la qualité du travail accompli ».
Malentendus et divergences
Encore une fois, il ne s’agissait pas, en quelque six mois à peine, de réécrire une histoire générale, mais de situer les représentations de cette histoire et de proposer des pistes pour les surmonter, dans le prolongement des travaux sur l’histoire des mémoires menés notamment par Pierre Nora ou Marc Ferro. Des « travaux pratiques » sur les effets de mémoire donc, plutôt que des recommandations politiques. Je me suis dès lors interrogé, en termes d’efficacité, sur l’opportunité de présenter des excuses, comme le Japon a pu le faire en 1995 à la Chine pour les crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre mondiale (déclaration Murayama). On peut également noter que le fait que les États-Unis aient présenté des excuses au Vietnam en 2009 par la voix de leur ambassadeur n’a pas empêché le développement du suprématisme blanc et les attaques contre les minorités au cours des années suivantes, comme le puissant mouvement trumpiste l’a démontré.
J’ai préféré plaider pour un travail de longue durée, par le biais des programmes de l’Éducation nationale notamment, mais aussi par la tenue d’un colloque sur les militants et intellectuels anticoloniaux, de François Mauriac à Henri Alleg, de Henri Jeanson à Pierre Vidal-Naquet et d’Edgar Morin à André Breton. À travers des figures symboliques comme celles de Gisèle Halimi ou Ali Boumendjel, je proposais que l’on dise à la société française ce qu’avait été le combat anticolonial. La reconnaissance en 2018 par le président de la République française de l’assassinat par les parachutistes français, sur les ordres du général Aussaresses, du militant communiste Maurice Audin, a créé une onde de choc ; il est à espérer que les militants Fernand Iveton, guillotiné en 1957, Henri Maillot, fusillé dans le dos par les gendarmes mobiles, et tous les Français ou Algériens d’origine européenne, qu’ils fussent chrétiens, juifs ou autres, s’étant battus contre l’armée française, seront un jour reconnus comme des militants de la cause anticoloniale.
Le point crucial de divergence se donne à voir au prisme combiné des divers imaginaires. En France, le débat demeure difficile à ouvrir sereinement, tant l’identité nationale française s’est en grande partie construite à partir de la notion d’Empire colonial, de ce qu’on a appelé la « plus grande France », au centre de laquelle se trouvait justement l’Algérie, territoire gigantesque dont la superficie, Sahara compris, équivaut à cinq fois celui de la métropole. L’Algérie n’avait pas le statut de « colonie » ou de « protectorat », mais celui de trois « départements français » d’Alger, de Constantine et d’Oran, plus les « Territoires du Sud ». L’indépendance de l’Algérie a été vécue en 1962 par une partie importante de la population française comme une amputation du territoire national et a occasionné une crise profonde du nationalisme français. Les républicains français, y compris à gauche, avaient pour leur part construit un imaginaire sur la « mission civilisatrice de la France », vision positive que les indépendantismes et la violence particulière de la guerre d’Algérie mettaient à mal. Il leur était extrêmement difficile de penser une nation algérienne séparée de la nation française et il a fallu des hommes courageux pour aller à contre-courant. Cette crise a pu être surmontée par la magie du verbe du général de Gaulle dans les années 1960, qui a réussi à faire passer l’histoire française de l’ornière de la décolonisation aux rails de la construction européenne. Mais la brûlure mémorielle n’a jamais vraiment cicatrisé, même si elle s’est atténuée avec l’arrivée de nouvelles générations qui n’avaient pas vécu eux-mêmes les événements.
Pour les Algériens, une histoire qui doit commencer par son début
En Algérie, l’histoire s’écrit toujours en opposition à cette histoire française, en réaction contre elle. Il s’agit pour l’Algérie de reconquérir son identité, en particulier son nom. Cette question du nom est cruciale et un point de mon rapport, que peu de personnes ont relevé, porte justement sur la question de la perte du nom propre. On parle plus volontiers des violences, des massacres, mais l’un des problèmes de la colonisation est la question de la hiérarchisation raciale qui en est le fond. Il y a bien sûr la dépossession foncière, la conquête coloniale, mais le rapport à l’identité de la personne est décisif. À certains égards, on ne peut pas faire pire que cela : l’administration française, ayant imposé que tous les Algériens portent des noms patronymiques (ce qui n’existe pas dans la façon de nommer en arabe), certaines personnes se sont vues qualifiées de SNP ou « sans nom patronymique » sur leurs papiers, perdant ainsi leur identité et leur filiation. Dans les années 1980-1990, il m’est arrivé de rencontrer des enfants de ces SNP. Il est dommage que cette problématique soit encore ignorée.
Pour avancer sur ces questions mémorielles, une restitution des faits historiques s’impose. Pour la plupart des Algériens que j’ai rencontrés au fil de ma longue exploration universitaire, cette histoire ne doit pas démarrer avec la guerre d’Algérie, mais remonter à la conquête coloniale, qui dure de 1830 à 1871 au moins (1902 en incluant les campagnes du Sahara), soit cinq fois plus longtemps que la guerre d’Algérie (1954-1962). Faute de quoi, le récit commence par la fin, par l’histoire violente, la guerre, les massacres et les tortures, l’exil des populations paysannes, le départ des Européens. La sauvagerie de la guerre doit être comprise dans une généalogie historique. Il faut aussi entrer dans la pluralité de l’histoire d’une société qui a existé dans les interstices de la colonisation, qu’a notamment mis au jour l’historien Gilbert Meynier[7].
Du côté algérien aussi, l’histoire officielle, celle qui est enseignée dans les écoles, ne commence qu’avec la guerre, c’est-à-dire au 1er novembre 1954, alors qu’elle devrait la faire commencer par l’émergence progressive d’un nationalisme algérien dans la durée, à travers le patriotisme rural, le nationalisme urbain, la fabrication des élites politiques, sans oublier le rôle de l’émigration ouvrière en France. La question, déjà posée par plusieurs historiens algériens, reste celle-ci : comment transcender la seule séquence guerre d’indépendance pour aller aux origines, à la généalogie, à la transmission de ce qui la précède ? Pour d’autres, journalistes et intellectuels, une autre question se pose : comment sortir d’une culture de guerre, du ressentiment, d’une mémoire ouverte sur l’avenir sans renier le passé ? Ainsi a-t-on pu lire dans Le Quotidien d’Oran du 29 avril 2021 sous la plume de Farid Lounis : « Le Rapport Stora est un manuel anti-ressentiment. Contre la rumination du passé qui intoxique et empoisonne le présent, il propose un passage à l’acte où l’apaisement des mémoires pourra se faire par le biais de l’étude et l’éducation. Par des actes concrets. Le but est d’aboutir à une conception de l’histoire comme “patrimoine culturel commun” entre la France et l’Algérie. Cela est largement profitable pour notre avenir – nous autres Algériens et Français – que les jérémiades postcoloniales qui ont tendance à s’imposer aujourd’hui comme un cinquième évangile ».
J’ai été aussi surpris aussi de voir certains chercheurs récuser ma description du «monde du contact» au temps colonial alors que les nationalistes algériens ont, tout au long de leur longue histoire, voulu se rapprocher de la gauche française, par le biais des syndicats notamment. Le refus de la gauche française de prendre en charge le combat pour l’indépendance n’a pas empêché que se consolident des liens d’amitié. Ce « monde du contact » a été décrit par l’historienne anticolonialiste Annie Rey-Goldzeiguer dans son ouvrage sur les origines de la guerre d’Algérie : « Décrire ce monde du contact est chose malaisée, car il ne s’agit ni d’une société, ni d’un groupe, ni d’une ethnie, mais seulement d’un monde d’une certaine communication où se tissent (qu’on le veuille ou non) certaines relations de voisinage, de vie côte à côte, d’habitudes communes, de modes vestimentaires et culinaires, de calendrier identique et de rythme de vie semblable. Avec le temps et le quartier, une structure mentale se crée qui rend l’autre visible et même acceptable (...) Au plus bas de l’échelle, les petits fonctionnaires des villages et des petites villes sont au contact direct de l’Algérien. Pour ceux-là, ils rendent des services, même s’ils sont de l’autre côté de la barrière. Les enseignants en particulier jouent un rôle considérable. J’emprunte à Ferhat Abbas son témoignage élogieux : “Les enseignants, dans une grande proportion, étaient des républicains, foncièrement démocrates. J’en ai connu de ces « missionnaires » de l’école française et de la science, dont le dévouement à l’élève autochtone n’avait d’égal que leur volonté de rapprocher les Algériens de la France[8].” Mieux que quiconque, ces instituteurs forgent les âmes et les intelligences des Ferhat Abbas, Mohammed Dib, Mouloud Feraoun et bien d’autres »[9] .
Ce monde ne représentait pas, contrairement à ce que certains ont prétendu, une « infime minorité ». En clôture du colloque organisé à Paris en novembre 2000 en hommage à Charles- Robert Ageron, le grand historien algérien Mahfoud Kaddache déclarait, en référence à ces deux mondes qui, il est vrai, se croisaient souvent sans vraiment se connaître : « Je rêve pour l’Algérie d’une histoire qui ne soit pas une histoire coloniale ni une histoire nationaliste mais une histoire des peuples, de leurs conditions, de leur culture et de leurs aspirations et où les jugements portés seraient exprimés en fonction des droits de l’homme à la dignité, à la liberté et à la vie, dans la paix et la justice. »
J’ai également été surpris que l’on m’accuse de renvoyer dos à dos agresseurs coloniaux et victimes. Pour- tant, restituer les différents groupes de mémoires de cette histoire dans leur pluralité n’implique nullement de faire siennes leurs positions idéologiques. Il suffit de lire dans mon rapport comment sont présentées les deux sociétés : l’une, algérienne, avec un imaginaire marqué par la perte de l’identité personnelle, la dépossession des terres et les massacres ; l’autre, française, toujours traversée par la nostalgie d’un Empire pour construire son imaginaire. Est-ce là bâtir un récit « asymétrique » ? Même si les convictions du chercheur entrent en ligne de compte dans l’élaboration du récit, le travail de l’historien est de rendre compte de tous les points de vue, de les pondérer. Disons aussi que les militants ne se vivaient pas comme des victimes, mais comme des combattants, ce que j’ai pu constater en établissant les biographies de Messali Hadj[10] et de Ferhat Abbas[11], mon Dictionnaire biographique de militants nationalistes algériens[12], rédigé de 1982 à 1985 à partir de la consultation de masse d’archives à Aix-en- Provence et le témoignage précieux d’une cinquantaine d’acteurs du mouvement national algérien ou encore ma thèse de doctorat d’État d’histoire soutenue en 1991, sur l’« Histoire politique de l’immigration algérienne en France (1922-1962) », qui met notamment en lumière la vie quotidienne et les combats politiques livrés par les ouvriers algériens. Mon rapport s’inscrit dans la continuité de mes travaux antérieurs avec la volonté de la progression du savoir historique, et ne se veut certainement pas un outil pour des réquisitoires à caractère strictement politique ou idéologique.
Dans un long texte publié sur sa page Facebook en mars 2021, le journaliste algérien Youcef Zerarka a ainsi tenu a à apporter son témoignage sur mon parcours intellectuel : « À coup de tweets, de posts et de pamphlets, d’aucuns accusent Benjamin Stora d’avoir qualifié les moudjahidines de “terroristes” dans le rapport remis au président français. J’ai lu et relu le document. Rien de tel n’y figure. [...] L’étudiant que j’ai été, le journaliste que je suis se rappelle que nous devons à Benjamin Stora deux biographies plus que complètes sur deux figures du mouvement national algérien : Messali et Ferhat Abbas (avec Zakya Daoud). L’étudiant que j’ai été, le journaliste que je suis se rappelle qu’au commencement de sa riche activité éditoriale – une quarantaine de livres seul ou en collaboration –, Stora avait signé un Dictionnaire biographique des militants nationalistes algériens. C’est bien ce qu’en atteste – pour la postérité – la couverture du livre. Connus pour ne pas être des familiers des librairies et bibliothèques, les “historiens” et autres chroniqueurs de la Toile nous auraient “révélé” que Benjamin Stora aurait écrit un “Dictionnaire biographiques des terroristes algériens” ! Le journaliste que je suis rappelle que, enseignant, il a encadré des chercheurs devenus membres de ce que Pierre Vidal-Naquet a qualifié “nouvelle génération des historiens” de la guerre d’Algérie. Désormais historiens accomplis et féconds sur le front du savoir académique, ces chercheurs ont soutenu – avec succès – des thèses sur des sujets originaux/fondateurs pour la plupart ! »
Propositions et travaux pratiques
Je n’ai donc pas cherché à découvrir ou à trouver des mots magiques, comme « repentance », qui clôturent un discours idéologique ou politique. Mon objectif était plu- tôt de commencer une histoire, de démarrer une période nouvelle, qui passerait de la sphère académique à la société réelle. Du point de vue académique, il existe déjà des centaines d’études publiées, que ce soit du côté français ou du côté algérien[13]. Comment tirer profit du savoir accumulé pour avancer pratiquement ? En prenant des exemples très concrets. Par exemple, j’ai abordé la question des disparitions à travers la figure d’Ali Boumendjel (1919-1957), un nationaliste enlevé puis assassiné. Le travail accompli par Malika Rahal, commencé dans les années 2010 avec sa thèse de doctorat sous ma direction, a rendu incontestables son enlèvement puis son assassinat, contrairement à certains propos en France niant toujours cette évidence. Ses petits-enfants ont été reçus le 2 mars 2021 par le président Macron, comme cela avait été le cas pour ceux de Maurice Audin (1932-1957), geste qui, notons-le, avait été mal reçu dans certains milieux. Ce sont des gestes qui s’inscrivent dans une démarche pratique de reconnaissance pour marquer la fin de mensonges d’État. Cet aspect du mensonge est décisif, et non pas l’ensemble des violences commises.
J’ai fait un certain nombre de propositions concrètes, par exemple au sujet des archives : les ouvrir, les restituer, comment, pourquoi ? Quand j’ai commencé à travailler sur l’histoire algérienne en 1974, seuls quelques universitaires, comme Charles-Robert Ageron, René Gallissot ou Gilbert Meynier, s’étaient engagés dans cette voie. L’Algérie et son histoire intéressaient peu de chercheurs. Il y avait là un problème d’absence, de trou de production de savoir académique, qui contrastait avec l’inflation d’autobiographies, de souvenirs personnels, de livres de mémoire. J’ai aussi été confronté à un problème d’archives, en rapport direct avec une perte de lieu : la perte de l’Algérie française a entraîné la perte du récit sur l’Algérie. La construction, la fabrication d’un potentiel archivistique n’existait pas. Il fallait par conséquent combler deux absences : celle du savoir académique et celle du territoire réel, puisque les archives étaient placées en situation d’exil, de déplacement géographique, se trouvant en grande partie à Aix- en-Provence. C’est une histoire peu commune : il n’y a pas d’équivalent dans l’histoire d’un pays ancien qui disparaît, y compris avec ses archives. Dans les autres instances de décolonisation, on passe d’un statut juridique à un autre mais les chercheurs ou les citoyens gardent les archives. Là, non : un pays a disparu avec ses archives, déplacées et en exil à la recherche desquelles l’historien doit se lancer. Très tôt, les Algériens ont eu à poser la question de la restitution de ces archives exilées.
Aujourd’hui, ces archives sont très largement ouvertes, même s’il existe encore des restrictions sur des données considérées comme « sensibles », comme la question du nucléaire. En Algérie, des historiens et chercheurs algériens ont fait valoir leur point de vue sur cette question et ont réclamé l’accès aux fonds d’archives en Algérie dans une lettre ouverte adressée au président de la République Abdelmadjid Tebboune et publiée le 25 mars 2021 dans plusieurs quotidiens. Dénonçant « les entraves bureaucratiques », ils ont exhorté le président algérien à ordonner l’application de la loi régissant les archives nationales « sans qu’interfèrent des interprétations personnelles qui vont à l’encontre de l’esprit même des archives qui sont un patrimoine de la nation ». Déplorant « le verrouillage incompréhensible » de l’accès aux archives depuis plu- sieurs décennies, les signataires ont estimé agir par devoir « moral » et « national » car ce blocage affecte « négative- ment les études historiques et le travail sur la mémoire nationale ». Ces universitaires se sont étonnés qu’en dépit de l’intérêt du chef de l’État algérien pour ce dossier, l’accès aux archives soit un parcours du combattant qui « vient à bout des chercheurs les plus opiniâtre». Dans le même temps, en France, à la suite de la publication du rapport, des historiens français ont poursuivi leur mobilisation commencée en juin 2020. Dans une pétition récente, publiée en juillet 2021, on pouvait lire : « Les archives n’appartiennent pas aux seules administrations qui les produisent. Elles sont le bien commun de la nation. Leur accès ne peut pas être gouverné par la défiance ou la peur ». À l’initiative du collectif « Accès aux archives publiques », historiens et personnalités, dont Raphaëlle Branche qui a consacré beaucoup d’énergie à cette bataille, Pierre Audin, Patrick Boucheron, Henri Leclerc, Isabelle Neuschwander, Michelle Perrot, Robert O. Paxton, Nicole Questiaux, Patrick Weil, Annette Wieviorka et moi-même, interpellons les parlementaires qui examineront le projet de loi : « C’est l’honneur de la République que de défendre le droit d’accès aux archives publiques ».
Une commission « Mémoire et Vérité » a été constituée. Une directrice de projet, Cécile Renault, a été recrutée à l’Élysée pour suivre la mise en œuvre des préconisations. La démarche se veut concrète. Revenir aux faits, mettre en place des groupes de travail qui réfléchissent à des questions pratiques, réaliser des objectifs précis. Depuis la remise du rapport, des premières réalisations existent.
Plus en un an qu’en soixante ans....
Quand ce rapport, qui a occasionné tant de bruit et de fureur, a été publié, certains pensaient que ce travail finirait au fond d’une armoire de l’administration. En fait, il a été accompli en un an plus que tout ce qui a été fait en soixante ans sur les questions mémorielles entre la France et l’Algérie.
Le 2 mars 2021, l’État français a reconnu l’assassinat d’Ali Boumendjel. Les experts du groupe de travail franco-algérien sur les essais nucléaires créé en 2008 se sont réunis les 19 et 20 mai 2021 ; ils ont pour mission d’étudier conjointement la question de la réhabilitation des anciens sites d’essais nucléaires au Sahara, avec pour préoccupation première la protection des personnes et de l’environnement. Concernant les archives, le Code du patrimoine a été modifié le 31 juillet 2021 pour permettre un accès facilité aux archives « secret défense », adjoint le 15 décembre 2021 d’une dérogation générale pour accéder aux archives relatives à la guerre d’Algérie.
Dans un hommage aux harkis le 20 septembre 2021, le président de la République a reconnu une dette de l’État français et a demandé pardon aux harkis et à leurs enfants. Au moment de la commémoration du 17 octobre 1961, jour de la violente répression des travailleurs algériens à Paris, le président de la République a reconnu « des crimes inexcusables pour la République ».
Le 5 février 2022 a été dévoilé un portrait de l’émir Abdelkader au bord de la Loire, au pied du château d’Amboise. Une signalétique des lieux de mémoire de l’histoire de la France et de l’Algérie est en cours de réalisation, elle sera accompagnée de code QR qui ren- verront à des contenus multimédias. La première signalétique a été installée le 10 décembre 2021 au camp de Thol (Neuville-sur-Ain), où près d’un millier d’Algériens furent internés entre 1958 et 1961.
Dans le cadre de la coopération universitaire, un appel à projet pour des bourses pour des doctorants et post- doctorants (bourses André-Mandouze) a été lancé en juillet 2021 et a rencontré un grand succès. Un appel à candidatures a également été lancé en mars 2022 pour accueillir en résidence des artistes algériens à la Cité inter- nationale des arts et à la friche La Belle de Mai (Marseille), soutenu par le ministère de la Culture et la SACEM. Les premiers lauréats sont arrivés. Au musée de l’Histoire de France et de l’Algérie à Montpellier, un projet d’insti- tut de la France et de l’Algérie a été élaboré. Une liste de noms d’intellectuels opposés à la colonisation et à la guerre d’Algérie a été établie pour renommer des rues. Un colloque international sur les oppositions intellectuelles à la colonisation et la guerre d’Algérie s’est déroulé les 20 et 21 janvier 2022 à l’Institut du monde arabe et à la Biblio- thèque nationale de France. La commission « Mémoire et Vérité » travaille également sur le statut et l’entretien des stèles des cimetières juifs et chrétiens en Algérie et sur la manière d’inciter les États à s’investir dans cette question. En effet, faire le deuil d’une terre perdue, c’est aussi faire le deuil des morts qui sont restés sur place et dont il faut honorer la mémoire. Malheureusement, parmi les articles qui ont traité de mon rapport, peu ont parlé de toutes ces questions qui disent l’énorme chantier mémoriel qui reste encore à mettre en œuvre.
Lorsque j’ai accepté la demande du président de la République de remettre un rapport sur la colonisation et la guerre d’Algérie, je savais que je m’engageais sur un chemin semé d’embuches. Entre exercices de travail historique classique, et engagements citoyens conduisant à des prises de positions politiques, j’ai essayé d’avancer. En consultant largement d’autres historiens, des intellectuels, des éducateurs, des responsables d’associations appartenant à différents groupes de mémoires (des pieds- noirs aux harkis, des immigrés aux anciens appelés), des pédagogues, des spécialistes de la conservation d’archives, j’ai entendu leurs remarques, leurs observations. J’ai souhaité confronter les points de vue, dans le respect de la diversité et de la pluralité des opinions, tout en sachant que les usages publics de l’histoire ont fait couler beau- coup d’encre au cours des dernières années. Je me suis inscrit dans la lignée des travaux de Pierre Vidal-Naquet qui affirmait dans son livre Les Assassins de la mémoire : « C’est la responsabilité des intellectuels que de dire la vérité, et de mettre à jour les mensonges ».
J’ai mesuré l’importance des mémoires et la diversité des histoires vécues ; l’exigence d’une histoire sachant articuler l’approche globale et la perception locale, qui ne soit pas repliée dans un récit essentialiste et unificateur, prenant en compte la richesse des différentes écritures historiques. J’ai encore mesuré toute l’importance de la transmission et de la valorisation de la connaissance historique par l’image, par l’audiovisuel et par les outils numériques. J’ai vu toute l’émotion des descendants des groupes de mémoires, à l’évocation de la reconnaissance par la France des assassinats de Maurice Audin et de Ali Boumendjel ; l’émotion toujours et encore très forte lorsque que le président de la République a prononcé la déclaration de pardon envers les harkis abandonnés en 1962, et les pieds-noirs qui ont été victimes de la fusillade de la rue d’Isly à Alger le 26 mars 1962 ; au moment de la dénonciation de la répression contre les travailleurs algériens à Paris le 17 octobre 1961... Tous ces gestes, ces déclarations permettront, je l’espère, l’ouverture d’une séquence mémorielle consacrée à cette période douloureuse de l’histoire française. Il s’agit là d’une mise en mouvement pour d’autres gestes, mais surtout pour la connaissance de toute cette période, encore mal connue, mal étudiée par la société et la jeunesse française.
Mon rapport, on l’aura compris, n’était donc pas un récit nouveau d’histoire académique, mais une suite de l’enquête sur la mémoire commencée il y a plus de trente ans. Où se croisent les éclaircissements apportés par les recherches érudites, les paroles d’acteurs blessés, les peurs du passé incroyablement vivaces... Entre histoire savante et histoire chuchotée dans l’intimité familiale, un chemin se dégage qui sera emprunté dans des commissions mixtes, je l’espère, par de nouveaux chercheurs algériens et français, américains et africains, et d’autres horizons encore...
Benjamin Stora. Décembre 2022
[1] Marie-Pierre Ulloa, de l’université de Stanford (États- Unis), y insiste sur l’aspect des références littéraires : https://aoc.media/analyse/2021/05/06/france-algerie-a-propos-de-larchitecture- narrative-du-rapport-stora/
[2] 1. Son article dans le Financial Times du 24 février 2021 est disponible ici : https://benjaminstora.univ-paris13.fr/index.php/actualit%C3%A9s/665-the-west-is-too-obsessed-with-its-colonial- guilt-france-s-stora-report-on-the-country-s-occupation-of-algeria- shows-that-the-colonised-also-need-to-face-up-to-their-past-in-the- financial-times
[3] « France-Algérie : l’héritage colonial », entretien avec Tahar Khalfoune et Benjamin Stora, propos recueillis par François Euvé et Nathalie Sarthou-Lajus, Études 2021/9, p. 19-31.
[4] .Je tiens cependant à préciser que je n’aurais pas pu poursuivre ce travail difficile si je n’avais pas eu à mes côtés Cécile Renault, chargée par l’Élysée de suivre et de mettre en œuvre les préconisations de mon rapport. Elle a accompli, avec persévérance, un travail remarquable ; et à dire aussi que les membres de la cellule diplomatique de l’Élysée, Emmanuel Bonne, Patrick Durel et Alice Rufo, n’ont jamais cessé de m’encourager, ainsi que la Conseillère culture Rima Abdul-Malak, actuelle ministre de la Culture.
[5] « Nous, filles et femmes de harkis, récusons le rapport Stora sur la guerre d’Algérie », tribune publiée dans Le Figaro du 27 jan- vier 2021.
[6] La traduction arabe est disponible ici : https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/09/c9cb9e2ba1e5e39f686f0ab 4b95c73d574d499e4.pdf
[7] Voir en particulier son livre sur l’émir Khaled (1875-1936), un officier de l’armée française porteur d’une idée nationale en son temps, L’Émir Khaled, premier za’îm ? Identité algérienne et colonialisme français, en collaboration avec Ahmed Koulakssis, L’Harmattan, 1987.
[8] Ferhat Abbas, Guerre et révolution d'Algérie. Tome 1 : La Nuit coloniale, Julliard, 1962, p. 114.
[9] Annie Rey-Goldzeiguer, Aux origines de la guerre d’Algérie, 1940-1945. De Mers-el-Kébir aux massacres du Nord-Constantinois, La Découverte, 2002, p. 73.
[10] Benjamin Stora, Messali Hadj (1898-1974), Le Sycomore, 1982, rééd. L’Harmattan, 1986, éd. de poche Hachette « Pluriel », 2005 ; trad. arabe aux éd. Casbah (Algérie), 2000.
[11] Benjamin Stora et Zakia Daoud, Ferhat Abbas. Une utopie algérienne, Denoël, 1994.
[12] Benjamin Stora, Dictionnaire biographique de militants nationalistes algériens - 600 portraits, L’Harmattan, 1985.
[13] Cf. B. Stora, Le Dictionnaire des livres de la guerre d’Algérie. Romans, nouvelles, poésie, photos, histoire, essais, récits historiques, témoignages, biographies, mémoires, autobiographies, 1955-1995, L’Harmattan, 1995, qui recense 2 500 titres.