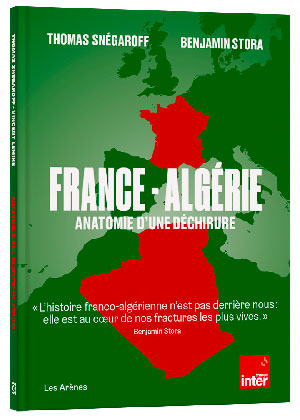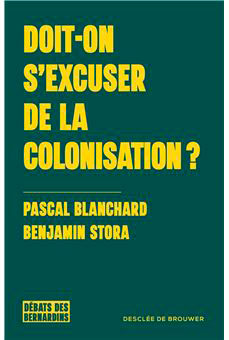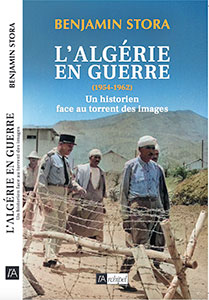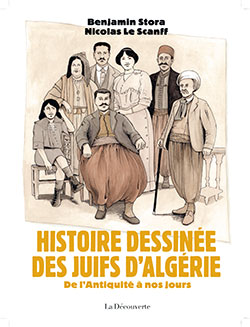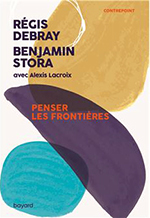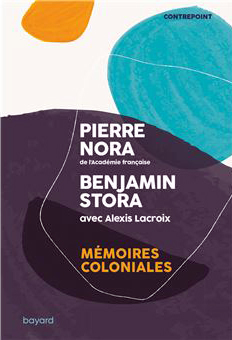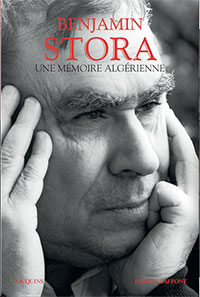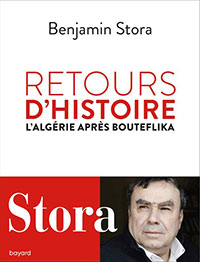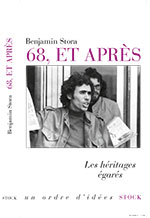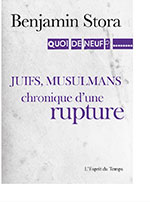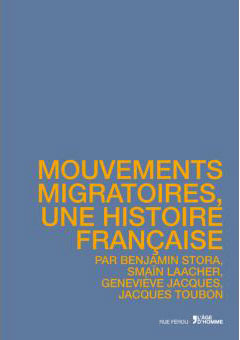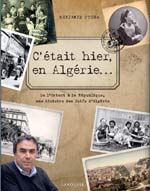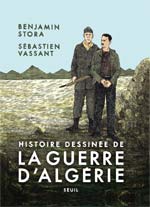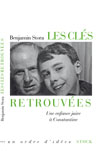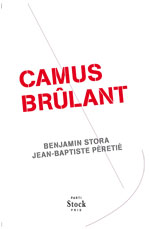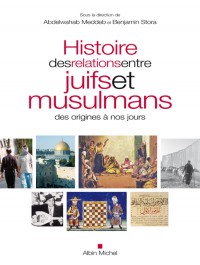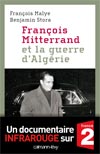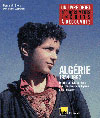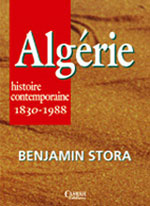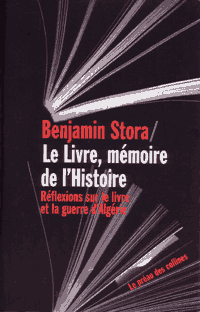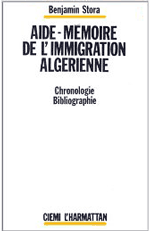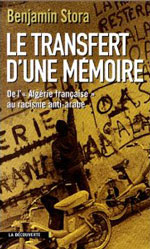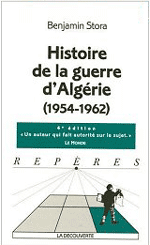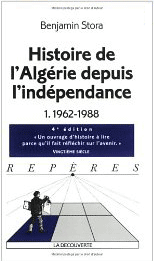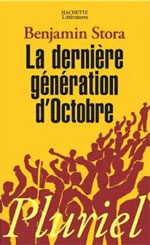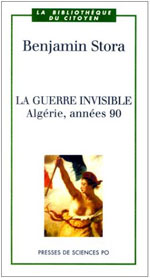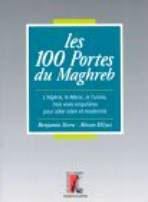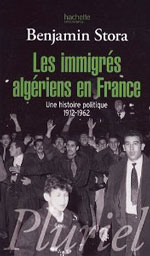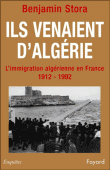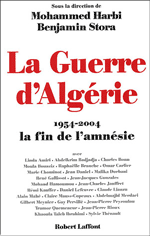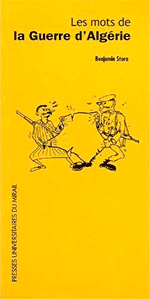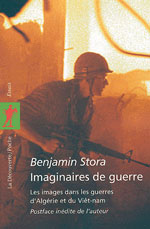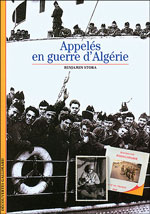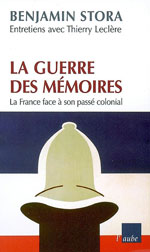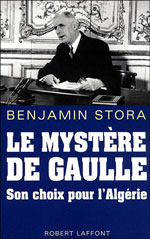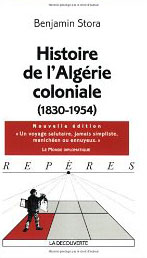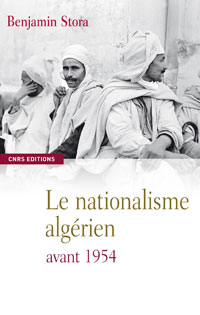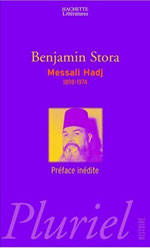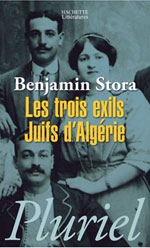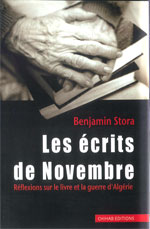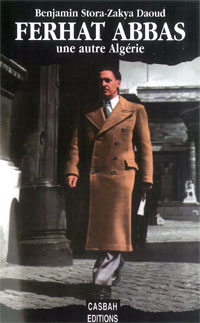Les saignements de la mémoire
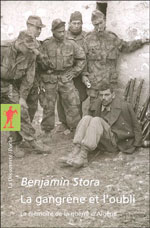 Cet ouvrage sur la mémoire de la guerre d’Algérie a été rédigé en 1990-1991. Trente ans après l’indépendance de l’Algérie, j’ai tenté de montrer comment cette guerre ne se finissait pas, dans les têtes et dans les cœurs. Parce que, de part et d’autre de la Méditerranée, elle n’a pas été suffisamment nommée, montrée, assumée dans et par une mémoire collective.
Cet ouvrage sur la mémoire de la guerre d’Algérie a été rédigé en 1990-1991. Trente ans après l’indépendance de l’Algérie, j’ai tenté de montrer comment cette guerre ne se finissait pas, dans les têtes et dans les cœurs. Parce que, de part et d’autre de la Méditerranée, elle n’a pas été suffisamment nommée, montrée, assumée dans et par une mémoire collective.La mise en mémoire qui devait permettre l’apaisement par une évaluation rationnelle de la guerre d’Algérie a été « empêchée » par les acteurs belligérants. Le lecteur verra comment se sont mis en place les mécanismes de fabrication de l’oubli de ce conflit inavouable ; comment les « événements » qui se sont produits entre 1954 et 1962 ont structuré en profondeur la culture politique française contemporaine ; comment une frénésie de la commémoration de la guerre, en Algérie, a fondé une légitimité militaire étatique, appuyée sur un parti unique.
En France, un oubli de la guerre, et en Algérie, un oubli de l’histoire réelle pour construire une culture de guerre…Bref, cet ouvrage d’histoire, La Gangrène et l’Oubli, entendait ne pas perdre de vue l’injonction de Freud, « N’oubliez pas l’oubli ! », en proposant une réflexion sur le décalage entre ceux qui doivent légitimement oublier pour continuer à vivre après la guerre d’Algérie, ceux qui souffrent de cruelles réminiscences, et ceux qui ne supportent plus, de part et d’autre de la Méditerranée, les trous de mémoire voulu, volontaire de cette guerre.
Que s’est-il passé depuis la première publication de 1991 ?
En Algérie, les effets de mémoire se sont amplifiés de manière redoutable. Nous sommes passés d’une culture de guerre à la guerre ouverte qui a fait, depuis l’interruption du processus électoral en janvier 1992, au moins 70 000 morts1. L’effacement du politique dans la représentation du nationalisme algérien au profit de la séquence-guerre contre la France coloniale signifiait que seule la violence permettait d’obtenir une revendication ; ou, au contraire, de maintenir des positions acquises. Il y a eu passage à l’acte. Avec la terrible violence des groupes islamiques pour conquérir le pouvoir, et une violence également terrible de l’État algérien pour se maintenir.
Dans le même temps, en France, le Front national poursuit sa progression, s’alimentant aux sources du refoulé de cette guerre. La perte de l’Algérie française apparaît comme la justification a posteriori du système colonial, par construction d’une mémoire de la revanche. L’assassinat du président d’une association de rapatriés, le Recours, Jacques Roseau, le 5 mars 1993, a fait rejaillir le spectre meurtrier de l’OAS dans l’actualité. Ce que reprochaient ses meurtriers à Jacques Roseau, c’était sa volonté de rapprochement avec les Algériens en effaçant les vieilles rancunes. Les milieux « ultras », nostalgiques de l’Algérie française, l’accusèrent d’être un « traître pro-arabe », « pro-FLN », d’autant qu’il s’opposait vigoureusement au discours raciste du lepénisme. Dans son livre paru en 1991, le 113e été, il écrivait : « Assassiner les Arabes, c’est un peu nous assassiner, assassiner l’Algérie de nos villages, assassiner nos rêves ». La transgression du tabou de l’Algérie française fut fatale à Jacques Roseau. En réponse à sa « trahison », autour de l’implacable logique, « les Algériens nous ont chassés, pourquoi vivent-ils encore en France ? », l’un des trois assassins du président du Recours déclara après son arrestation : « Je suis un ancien de l’OAS, et je le serai jusqu’à ma mort. » Même profession de foi, à son procès, du meurtrier d’un jeune comorien assassiné à Marseille en 1997…
Mais derrière les « durcissements » de mémoire, en France et en Algérie, d’autre lignes se dessinent. Dans la nouvelle guerre que connaît l’Algérie, une autre nation émerge, et l’État perd progressivement le contrôle du monopole d’écriture de l’histoire. La presse algérienne rend compte de rencontres ou colloques organisés autour de personnages longtemps mis au secret, comme Ferhat Abbas ou Messali Hadj : « On pourrait être tenté d’opposer à cet ensemble de signaux leur modestie, leur fragilité. En vérité, et au-delà des cas Messali ou Abbas et de la forte charge affective et politique qui les entoure, c’est bien un processus en cours qui signale la virtuelle obsolescence du contrôle politico-policier sur des pans entiers de l’histoire du pays2. »
La France, de son côté, connaît depuis 1992 un accroissement considérable de travaux, publications, films de fictions et documentaires, expositions autour de la guerre d’Algérie. Cette connaissance s’accompagne d’une reconnaissance de cette guerre. Le secrétariat d’État aux Anciens combattants entend promouvoir un « Mémorial », au centre de Paris, des soldats tués en Algérie. L’inauguration de ce lieu de mémoire, semblable dans sa conception à celui édifié à Washington pour les anciens du Viêt-nam, doit se faire en 2002. Les associations de rapatriés se félicitent des mesures d’indemnisation prises en leur faveur, et les chercheurs peuvent commencer à consulter les premières archives militaires françaises ouvertes depuis 1992. Ces « progrès » n’empêchent pas les saignements de mémoires.
Les enfants d’immigrés algériens réclament toujours justice pour leurs pères tués un soir du mois d’octobre 1961, et les fils de harkis se vivent toujours comme des « oubliés de l’histoire ». De l’autre côté de la mer, la jeunesse d’Algérie ne comprend pas pourquoi « on » a assassiné, le 29 juin 1992, un des pères de la révolution algérienne, Mohamed Boudiaf… Dans les urgences du présent, les exigences de mémoire restent. L’écriture de l’histoire de la guerre d’Algérie ne fait que (re)commencer.
[1] Amnesty International, Fédération internationale des Droits de l’Homme, Human Rights Watch, Reporters sans Frontières, Algérie, le livre noir, La Découverte, Paris, 1997.
[2] Chaffik Benhacène, « Le débat est ouvert sur les pères du nationalisme algérien », La Tribune, 21 mai 1998.