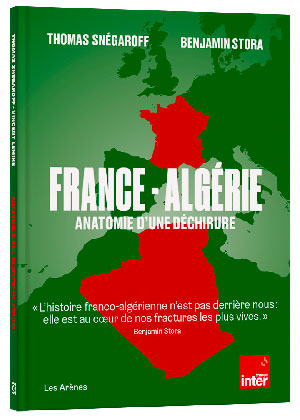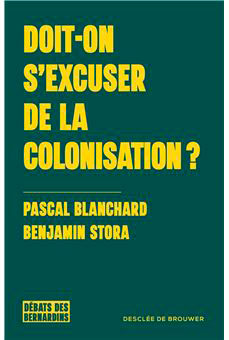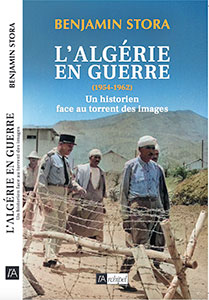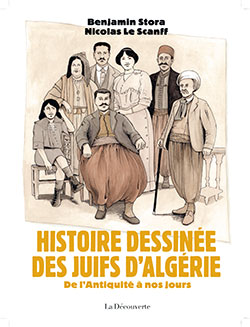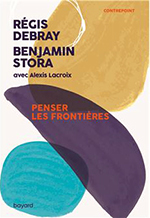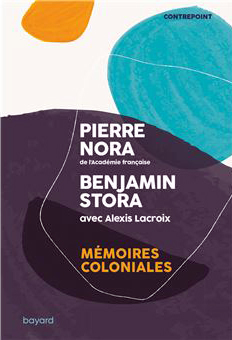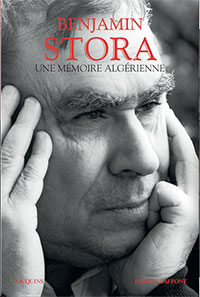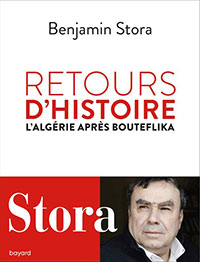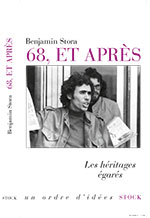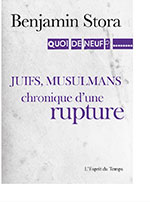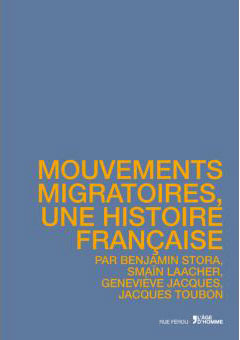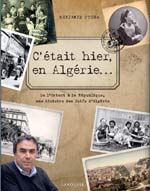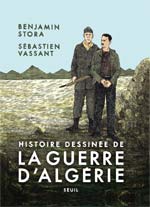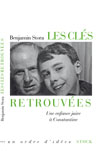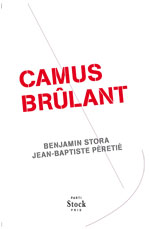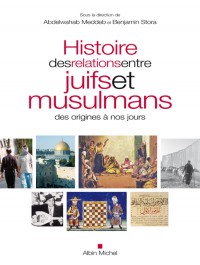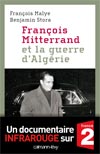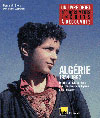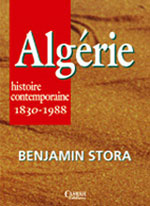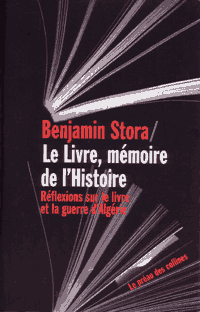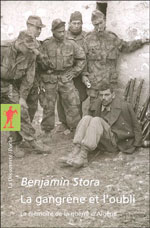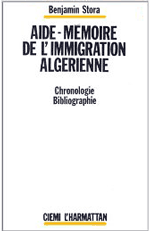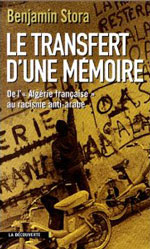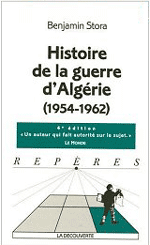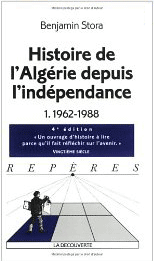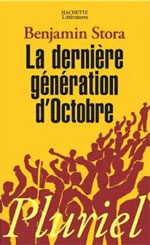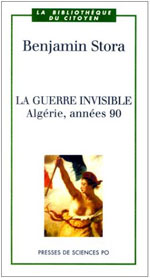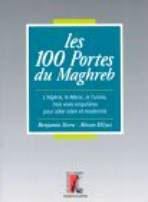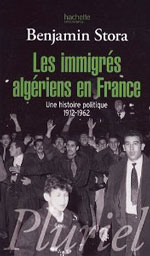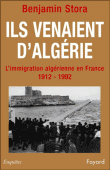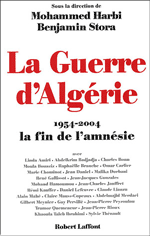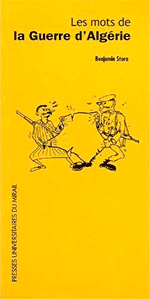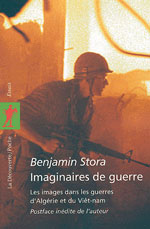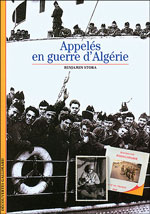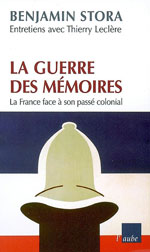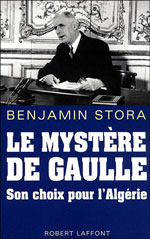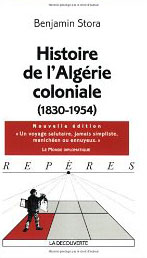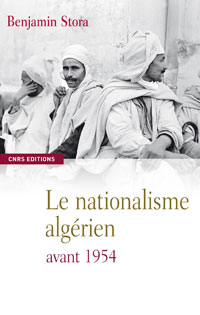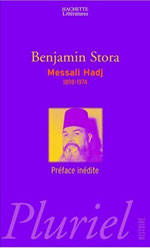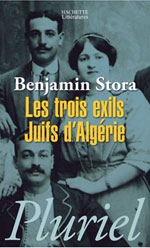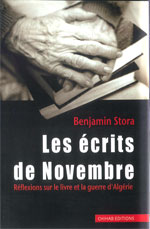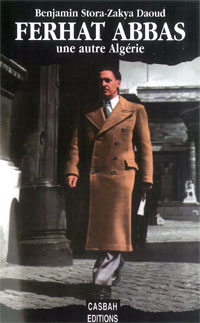Le 89 arabe : dialogue avec Edwy Plenel - Benjamin Stora, éd. Stock 2011, publié le 03/11/2011.
 Dialogue entre le journaliste Edwy Plenel et l'historien Benjamin Stora sur les révolutions en cours, Le 89 arabe questionne l'actualité et ouvre au lecteur de nouvelles perspectives.
Dialogue entre le journaliste Edwy Plenel et l'historien Benjamin Stora sur les révolutions en cours, Le 89 arabe questionne l'actualité et ouvre au lecteur de nouvelles perspectives.
« Les révolutions en cours ont su écrire leur propre histoire en épousant la nôtre, nos peurs, nos aveuglements, nos ignorances »
Les multiples histoires des révolutions arabes
Commenter une révolution en direct n’est pas une simple tâche, c’est une activité constamment sujette aux incertitudes d’une histoire qui s’amuse à décevoir les plus hardis de ses explorateurs. Les révolutions, comme le soulignent Benjamin Stora et Edwy Plenel dans la préface de leur Le 89 arabe, ouvrent « l’horizon des possibles », et posent donc un défi à la narration historique de cet évènement.
Ce défi historiographique, Stora et Plenel le relèvent en adoptant le style du dialogue, un style plus ouvert et plus contradictoire que l’essai ou la thèse, un style qui met en valeur la contingence et la radicalité de l’événement. Et ce qui émerge de ce dialogue à deux voix est une histoire des révolutions, moins linéaire, moins affirmative, mais plus vivante, une histoire à plusieurs temporalités, qui permet d’exhumer sous « les fausses évidences et… les illusoires certitudes » les différentes trajectoires de ces révolutions. Et cette histoire à plusieurs temporalités, les deux auteurs la maîtrisent bien, à partir de leurs professions respectives, celle d’un journaliste qui décrypte l’immédiat et celle d’un historien qui traque la longue durée.
Cette généalogie, plutôt qu’histoire, de ces révolutions arabes est une série de « reprises d’histoire », pour reprendre les termes de Stora, qui tisse plusieurs trajectoires autour de cet événement. Dans ce sens, les révolutions arabes sont un retour aux révolutions de 1989, mais plus fondamentalement un retour à la révolution démocratique de 1789, à ce « printemps des peuples essentiellement démocratiques, dans sa genèse comme dans son exigence », qui sera plus tard étouffé par les révolutions avant-gardistes du XXe siècle. Mais elles sont aussi la reprise d’une autre histoire, plus arabe et plus récente, celle de la décolonisation et de ses espoirs, quand « pendant un court moment les peuples arabes se vivaient comme étant au cœur de l’agenda mondial », une histoire avortée par les contre-révolutions des systèmes à parti unique, des républiques transformées en monarchie, et des régimes socialistes
privatisés par la famille régnante. Et dans ce même mouvement de reprise d’histoire, ces révolutions réactualisent une histoire plus ancienne, l’histoire d’une ouverture sur la modernité, souvent idéalisée ou démonisée mais toujours désirée, qui commence avec la Nahda et se termine avec les déceptions successives du XXe siècle.
La toile que tissent Stora et Plenel est centrée autour du monde arabe et de ces révolutions, mais ne se limite pas à ce monde qui, depuis le XIXe siècle au moins, ne peut se penser en dehors de l’Europe. L’histoire qui en dé- coule est polyphonique, à plusieurs voix, parfois consonantes mais souvent dissonantes. Et les révolutions, même si elles forment un événement arabe, sont globales dans leur portée, formant un des mouvements dans cet échange entre l’Orient et l’Occident. Pour Stora et Plenel, ces révolutions ne peuvent être appréhendées sans ce moment fondateur que fut le colonialisme, et son histoire que l’Europe ne parvient toujours pas à affronter. Elles ne peuvent pas également être comprises en dehors du « traumatisme algérien » et de ce dilemme meurtrier qui se mit en place dès le début des années 90, entre dictature militaire et violence islamiste. Et que dire du monde arabe qui a puisé en Europe, à la fois sa Nahda et son nationalisme, cette « queue de comète des totalitarismes européens ». Et ce mimétisme apparaît clairement dans les révolutions en cours qui, pour reprendre les termes de nos auteurs, « ont su nous renvoyer le miroir que nous voulions. Ils ont su écrire leur propre histoire en épousant la nôtre, nos peurs, nos aveuglements, nos ignorances ». En récupérant ces temporalités et ces voix, que les théories des dernières décennies ont étouffées sous des déterminations culturalistes, Stora et Plenel redonnent à cet événement sa vraie portée radicale en mettant paradoxalement l’accent sur son côté normal et prévisible. Les révolutions arabes n’ont surpris que les tenants des thèses d’exception sur le monde arabe, qui aveuglés « par un trop-plein de politique », n’ont pas entendu la « sourde révolte » qui grondait depuis plus de trois décennies et ont perdu l’espoir dans les dynamiques de modernisation sociale et politique, lentes mais sûres.
En regardant de plus près ces sociétés, en dehors du prisme du traumatisme algérien ou du conflit des civilisations, ces révolutions redeviennent prévisibles, une réaction normale de sociétés profondément bouleversées depuis des décennies. Et la radicalité de ces révolutions apparaît enfin comme étant non pas une radicalité de la nouveauté, mais plutôt une radicalité de la normalité. Et cette reprise du normal, pour paraphraser Stora, donne une portée universaliste à ce monde arabe, longtemps placé en marge de l’histoire, ce monde qui s’ouvre au moment où la France se replie sur « une identité nationale fixe et unique, celle d’une France de l’origine construite de manière continue ». Et dans ce contraste peut-être se trouve la réponse à la question de Plenel : « Et le message universalisable des révolutions arabes ne serait-il pas, tout simplement, un retour aux sources de la promesse démocratique, non seulement chez eux, mais aussi chez nous ? »
Samer Frangié
Le 89 arabe de Benjamin Stora et Edwy Plenel,
Paris, Stock, 2011, 180p.