Renaud de Rochebrune, Benjamin Stora. Editions Denoël, octobre 2011. Préface de Mohammed Harbi
Introduction de l'ouvrage
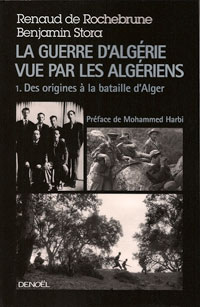 « La lutte s’est engagée entre deux peuples différents, entre le maître et le serviteur. Voilà tout. Il est superficiel de parler comme le font les journaux d’un réveil de la conscience algérienne. C’est là une expression vide de sens […]. Les Algériens n’ont pas attendu le xxe siècle pour se savoir algériens. » Le montagnard kabyle qui écrit ces lignes fin 1955, un an après le début de la guerre d’Algérie, n’est pas un indépendantiste radical.
« La lutte s’est engagée entre deux peuples différents, entre le maître et le serviteur. Voilà tout. Il est superficiel de parler comme le font les journaux d’un réveil de la conscience algérienne. C’est là une expression vide de sens […]. Les Algériens n’ont pas attendu le xxe siècle pour se savoir algériens. » Le montagnard kabyle qui écrit ces lignes fin 1955, un an après le début de la guerre d’Algérie, n’est pas un indépendantiste radical.
Encore moins un propagandiste du FLN, dont il approuve le combat nationaliste mais dont il dénoncera régulièrement tout au long du conflit les exactions contre les civils dans son journal, qui sera publié en 1962 peu après sa mort. Cet auteur, l’instituteur et romancier plutôt francophile Mouloud Feraoun , apportera d’ailleurs volontiers quelques mois plus tard, à l’orée de l’année 1956, son concours à Albert Camus qui veut tenter d’instaurer une « trêve civile » entre les belligérants, autrement dit leur faire signer un accord pour protéger au moins les « innocents » des effets dramatiques du conflit meurtrier. Mais après l’échec de cette initiative quelque peu utopique pour instaurer une guerre « propre », vite sabordée d’ailleurs par des « ultras » de la colonisation, il apostrophera ainsi, dans son même journal et dans le même état d’esprit, le futur prix Nobel de littérature ainsi que son collègue écrivain d’Oran Emmanuel Roblès , qui étaient — et resteront — de ses amis : « Enfin, ce pays s’appelle bien l’Algérie et ses habitants les Algériens. Pourquoi tourner autour de cette évidence ? […] Dites aux Français que le pays n’est pas à eux, qu’ils s’en sont emparés par la force et entendent y demeurer par la force. Tout le reste est mensonge, mauvaise foi. »
Vu d’aujourd’hui, même si quelques nostalgiques des temps coloniaux pourraient encore vouloir les contester, nul ne saurait évidemment être étonné ni même choqué outre mesure par ces propos d’un « indigène » plutôt favorisé mais avide d’émancipation. Pourtant, qu’un « discours » aussi vigoureux ait pu être tenu à cette époque, peu de temps après le déclenchement de la guerre et plus de six ans avant sa conclusion encore difficile à imaginer, par un écrivain modéré et pondéré, s’adressant de surcroît à des amis français réputés compréhensifs envers les revendications politiques des Algériens musulmans, est instructif. Par sa vivacité même, il témoigne à quel point les lectures de la situation en Algérie, même par des hommes éclairés des deux bords, étaient irréconciliables dès le début du conflit — et certainement depuis toujours, d’ailleurs, pour la grande majorité des intéressés. Selon qu’on était « musulman » ou « européen », comme on disait alors, et sauf exception, on ne parlait tout simplement pas le même langage, on n’éprouvait pas les mêmes sentiments. Ni face au passé ni face au présent, caractérisés par un statut politique, économique et social si différent — et inégal — pour les uns et les autres. Camus , ici mis en cause par un ami algérien, n’a pourtant pas encore « choisi sa mère », comme il le dira fin 1957 pour expliquer son horreur du terrorisme mais aussi un attachement indéfectible au « fait français » et à une solution fédérale en Algérie excluant formellement l’indépendance que ses engagements politiques «progressistes » ne laissaient pas prévoir aux yeux de beaucoup. Et Mouloud Feraoun , bien que lucide sur l’enjeu du conflit, ne s’apprêtait nullement au milieu des années 1950 à abandonner ses convictions humanistes pour le maniement du fusil. Le prouvera si nécessaire son comportement ultérieur, notamment comme inspecteur des très « offi ciels » centres sociaux créés à l’initiative de l’ethnologue Germaine Tillion à travers l’Algérie, jusqu’à son assassinat par un commando de l’OAS juste avant la fin de la guerre.
L’étonnant, c’est qu’un demi-siècle plus tard, même si cette incompréhension a pris en général d’autres formes, le conflit, malgré la quantité et la qualité des travaux d’historiens de tous bords à son sujet, est encore « lu » de façon totalement différente par la très grande majorité des Français et des Algériens. Comme si, en forçant un peu le trait, il ne s’agissait pas de la même guerre. Qu’il s’agisse de ses principales causes immédiates ou lointaines, des grands événements qui ont scandé ou infléchi de façon décisive son déroulement, de l’identité des héros des combats politiques ou militaires de 1954 à 1962, on ne cite pas les mêmes faits, les mêmes hommes, les mêmes actions au nord et au sud de la Méditerranée. Le cas a beau ne pas être unique ni même exceptionnel — il en est de même depuis plusieurs siècles pour les Croisades selon qu’on est chrétien ou musulman, depuis plusieurs décennies pour la guerre du Vietnam selon qu’on habite Hanoï ou Washington, etc. —, il est caricatural. Particulièrement en ce qui concerne la vision de la guerre par les Français, qui, le plus souvent, ne tient aucun compte, ou presque, de ce qui s’est alors réellement passé dans l’autre camp.
Ne prenons que quelques exemples concernant le seul premier tome du livre, donc la période qui va jusqu’en 1957. Quel Français qui ne serait pas particulièrement informé désignerait Abane Ramdane , le principal organisateur d’un congrès décisif du FLN en plein maquis deux ans après le début de l’insurrection, comme l’acteur algérien peut-être le plus marquant de la première moitié de la guerre ? Ou aurait l’audace ou simplement l’idée d’avancer, ce qui serait pourtant judicieux à bien des égards comme on le verra, que le véritable lancement « militaire » du confl it armé a eu lieu seulement en août 1955, presque un an après le déclenchement de l’insurrection nationaliste du 1er novembre 1954 ? Ou encore ne serait pas sidéré en apprenant que dès 1955, dans le Constantinois, la population musulmane pouvait croire que des troupes égyptiennes venaient de débarquer en grand nombre au nord de la région pour venir apporter un appui décisif aux maquisards du FLN et défaire militairement à l’horizon de quelques jours l’armée du colonisateur ? Ou enfin, pour terminer cette rapide énumération, ne serait pas surpris d’apprendre que le premier grand attentat à l’explosif visant aveuglément des civils dans la capitale de l’Algérie, terriblement meurtrier et annonciateur de ce qu’on appelle généralement la « bataille d’Alger », ne fut pas perpétré à l’été 1956 par des poseurs de bombes du FLN mais par des terroristes « pieds-noirs » liés à la police républicaine ?
Rien d’étonnant, après cela, si les grandes dates de la « guerre d’indépendance » ou « guerre de libération » qu’on commémore régulièrement en Algérie depuis 1962 ne signifi ent souvent pas grand-chose pour un Français ! Voilà pourquoi il nous a paru utile de proposer à un public qui dépasse celui des seuls spécialistes, pour satisfaire son envie de savoir ou une saine curiosité mais aussi sa soif de comprendre ce qui s’est vraiment passé entre 1954 et 1962 dans les deux camps, cette autre histoire de la guerre d’Algérie. Il s’agira ici de la raconter telle qu’elle a été vue, vécue et relatée par les Algériens. Ou telle qu’elle aurait pu être décrite il y a un demi-siècle dans les journaux français les plus sérieux par un hypothétique envoyé spécial derrière la ligne de front — si l’on peut dire, puisqu’une telle ligne n’a bien entendu jamais existé. Un envoyé spécial qui, du début à la fi n de la guerre, aurait rendu compte honnêtement de la situation de l’autre côté, du côté algérien, en accompagnant les combattants en opération, en parlant avec leurs chefs — sur le terrain en Algérie comme à l’étranger au Caire, à Tunis ou ailleurs —, en se mêlant à la population des villes comme des campagnes et en se demandant ce qu’elle vivait et ce qu’elle pensait. Son « reportage », c’est celui-là même qui ne fut jamais réalisé pendant ce conflit alors que les autorités françaises, affirmant contre toute évidence ne faire que du maintien de l’ordre, ne permettaient même pas qu’on parle de guerre, donc, notamment, qu’on puisse mesurer l’ampleur de la geste nationaliste algérienne. Ce récit aurait été surprenant à plus d’un titre à ce moment-là, on l’a compris, et même choquant peut-être en raison de la « compréhension » qu’il aurait nécessairement manifestée pour toutes les actions — y compris les moins défendables — de ceux qu’il observait et côtoyait, pour ses lecteurs de métropole. Il n’aurait sans doute pas moins surpris ceux d’Algérie. Mais il était manifestement impossible à entreprendre à cette époque. Aujourd’hui, grâce aux innombrables témoignages — publics ou non — des acteurs algériens des événements, grâce aussi aux centaines d’ouvrages et de recherches plus ou moins facilement consultables des historiens de toutes origines, on peut reconstituer assez bien ce qu’aurait pu être un tel reportage au long cours sur la guerre des Algériens, sans grand risque de travestir outre mesure la réalité vu la variété et la multiplicité des sources et des moyens de les contrôler. Les seuls mémoires d’acteurs algériens de la guerre consignés dans des livres publiés occupent par exemple plusieurs rayons de bibliothèque — l’historien Mohammed Harbi , le préfacier de cet ouvrage, en a dénombré récemment 132 à son domicile. Ceux des acteurs français, qui permettent souvent de compléter ou « sécuriser » les informations en croisant les récits, ne sont pas moins nombreux.
Ce n’est pas, pourtant, qu’il soit toujours facile de reconstituer les faits. Un demi-siècle après la fin de la guerre, comme on le verra, on ne peut encore donner avec une totale certitude la date au jour près de la réunion d’un groupe de militants indépendantistes qu’on a appelée — à tort peut-être, on le verra — la « réunion des vingt-deux », autrement dit cette rencontre historique au cours de laquelle fut décidé environ quatre mois avant le 1er novembre 1954 par une poignée d’hommes le lancement de la lutte armée et donc le principe de l’entrée en guerre. Ou proposer un récit qui fera l’unanimité de la mort de Mostefa Ben Boulaïd , l’un de ces six « chefs historiques » du FLN qui choisirent définitivement le 23 octobre 1954 la date du 1er novembre pour organiser le début de l’insurrection dans tout le pays, même si la version qui attribue son décès fi n mars 1956 dans les Aurès au parachutage suivi d’un maniement imprudent d’un poste radio piégé par les services secrets français est la plus communément admise. Ou fournir sans aucun risque de se tromper l’identité de l’individu — était-il d’ailleurs à coup sûr un combattant du FLN comme on le pense en général ou plutôt, comme d’aucuns le soutiennent encore aujourd’hui, un provocateur ? — qui a exécuté à la toute fi n de l’année 1956 le très infl uent et très extrémiste président de la Fédération des maires d’Algérie Amédée Froger au cours d’un attentat aux énormes conséquences. Mais on peut en tout cas dire comment ces « épisodes » furent vécus du côté algérien et présenter après les avoir évaluées des hypothèses fondées sur des sources sérieuses pour les raconter en limitant au minimum inévitable la part de l’incertitude. Une part qui, dans les nombreux cas où elle persiste, sera toujours signalée au fil du texte par les auteurs.
Ces derniers ont décidé de reporter à la fin du livre, chapitre par chapitre, la mention et — quand c’était nécessaire — le commen taire des sources et de la façon dont elles ont été utilisées. Il s’agit de faciliter la lecture de l’ouvrage pour le non-spécialiste en évitant d’alourdir chaque page d’innombrables références, souvent répétitives. Mais aussi de permettre à chacun, autant que possible, de suivre les événements et leur contexte dans le cadre d’un récit continu. Certes, il était évidemment impossible de raconter la guerre d’Algérie, même évoquée du seul point de vue — d’ailleurs pluraliste — des Algériens, dans tous ses détails et sans omettre aucun fait de quelque importance dans le cadre d’un ouvrage d’une dimension raisonnable, fût-il en deux tomes.
Voilà pourquoi s’est imposé le choix d’un déroulement du livre fondé sur les « dates » les plus marquantes ou les plus révélatrices de la guerre dans sa version algérienne. Dix dates, cinq pour chacun des deux tomes de l’ouvrage. Chaque chapitre commence ainsi par le récit très détaillé, aussi éloigné que possible des récits « offi ciels », d’un de ces événements ou épisodes (l’attaque de la poste d’Oran, le 1er novembre, l’offensive d’août 1955, etc.), suivi d’un long « flash-back » permettant de revenir en arrière pour ne rien manquer d’important concernant le déroulement du conflit entre les « dates » retenues. Ainsi que pour situer le contexte et faciliter l’intelligibilité de ces « moments » de la guerre choisis pour leur aspect exemplaire « vu par les Algériens ». Une méthode qui, du moins l’espérons-nous, permet, sans viser à l’exhaustivité, de ne rien omettre d’essentiel. Et de proposer un livre qui, bien que s’appuyant volontiers sur des documents ou des témoignages inédits, n’entend pas renouveler véritablement la recherche historique proprement dite sur la guerre d’Algérie mais a plutôt pour ambition de la faire « lire » en suivant un chemin jusqu’ici peu emprunté. Et de mieux faire comprendre pourquoi, dès qu’on parle de cette guerre, il est si difficile encore aujourd’hui d’évoquer la même histoire et donc de mettre un terme à la guerre des mémoires des deux côtés de la Méditerranée.


















































